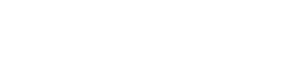QUI A PEUR DES FEMMES PHOTOGRAPHES ? LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX HORIZONS
Thèmes: Arts, Peinture, Société Conférence du mardi 21 janvier 2025
Par Madame Catherine ANTRAYGUES, conférencière, historienne de l’art.
INTRODUCTION
Les années 1830 voient naître la photographie, un domaine qui intéressera les femmes dès le début car de par sa nouveauté la photographie n’était pas empreinte du fort paternalisme voire machisme qui touchait l’univers de la peinture ou de la sculpture par exemple. La photographie a été un outil d’expression et d’émancipation pour certaines femmes.
En France, les études sur les femmes photographes sont peu nombreuses au contraire des pays anglo-saxons et scandinaves, de ce fait peu de photographes françaises sont répertoriées. Cependant, au cours des dernières années la recherche évolue et l’on redécouvre les travaux de photographes oubliées.
I- Les marges anglaises.
La photographie a bénéficié de nombreuses innovations technologiques et techniques dans les domaines de l’optique, de la chimie, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique et de l’informatique. Plusieurs inventeurs dont Joseph Nicéphore Niepce, Louis Daguerre en France et William Fox Talbot en Grande-Bretagne mettent au point des procédés pour fixer les images.
En 1839, Daguerre (1787-1851) promeut son invention auprès du savant et député François Arago qui le soutient et décide de ne pas breveter l’invention afin qu’elle se diffuse rapidement et soit accessible à tous. En Grande-Bretagne, William Fox Talbot mène des recherches parallèles et invente le calotype, procédé négatif-positif qui permet la diffusion multiple des images ; à l’inverse des Français, Talbot gardera son brevet et ses utilisateurs devront s’acquitter de droits. Ainsi, ce sont les milieux très aisés et l’aristocratie qui s’adonnent à la photographie qui devient le loisir à la mode. La sœur de Talbot introduit ce phénomène à la Cour et rapidement l’album-photo fait fureur.
Si les classes privilégiées pratiquent la photographie comme passe-temps, les scientifiques y voient une opportunité pour aider leurs recherches.  C’est le cas de la botaniste Anna Atkins, fille d’un célèbre naturaliste, qui fait partie de la British Botanical Society (une des rares à accepter les femmes) et qui publie en 1843 le premier ouvrage en impressions : l’album intitulé British Algae Cyanotype. Le cyanotype n’est pas une photographie au sens propre, mais un procédé de reproduction par effet « négatif » que permet de créer des images monochromes en bleu.
C’est le cas de la botaniste Anna Atkins, fille d’un célèbre naturaliste, qui fait partie de la British Botanical Society (une des rares à accepter les femmes) et qui publie en 1843 le premier ouvrage en impressions : l’album intitulé British Algae Cyanotype. Le cyanotype n’est pas une photographie au sens propre, mais un procédé de reproduction par effet « négatif » que permet de créer des images monochromes en bleu.
La famille Dillwyn s’intéresse également à la photographie. John Dillwyn développe de nouvelles techniques photographiques et sa sœur Mary (1810-1906) est l’une des premières femmes photographe du Pays de Galles. Elle photographie essentiellement des fleurs, les animaux et sa famille dans les années 1840 à 1850. Sa nièce, Thereza Dillwyn Llewelyn (1834-1926) est astronome et sera une pionnière de la photographie scientifique.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, c’est la mode des photo-cartes et la photographie explose. De nombreuses femmes sont recrutées pour retoucher les clichés car le travail demande beaucoup de soin. Des millions d’exemplaires de photo-cartes sont produits en un demi-siècle.
Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, deux artistes photographes se distinguent : Clementina Hawarden (1822-1865) et Julia Margaret Cameron (1815-1879).
Clementina Hawarden est une noble qui s’intéresse à la photographie et elle est l’une des photographe amatrice les plus connues de l’époque victorienne. Elle aménage un studio dans sa demeure londonienne et réalise plus de 800 clichés essentiellement de ses filles. Quant à Julia Margaret Cameron elle réalise essentiellement des portraits de personnalités de son époque comme le savant J.F Herschel ou le poète Alfred Tennyson. Elle transpose à la photographie les critères esthétiques de la peinture. Elle photographie aussi beaucoup l’enfance et sera une des premières à faire des gros plans.
II- L’avant-garde américaine.
Aux Etats-Unis au contraire de ce qui se passe en Grande-Bretagne, les femmes voient en la photographie un moyen de gagner leur vie et donc un moyen d’émancipation. Ainsi nombre d’entre elles font partie de mouvements féministes, très nombreux à la fin du XIXe siècle. Cette lutte permettra aux Étasuniennes d’obtenir le droit de vote et le droit d’éligibilité dès 1920.
Frances Johnston (1864-1952) est une des premières photographe et photojournaliste américaine. Elle se forme au dessin et à la peinture à Paris, de retour aux Etats-Unis elle dessine pour plusieurs magazines puis travaille pour George Eastman après que celui-ci lui ait offert un appareil Kodak. Elle publie en 1897 un article intitulé What a woman can do with a camera, où elle détaille les conseils de création d’un atelier photo pour en faire une activité professionnelle. Elle réalise plusieurs autoportraits en femme défiant les normes de l’époque : elle se travestie en homme, fume etc. 
C’est également le cas de Gertrude Kasebier (1852-1934) qui elle aussi ouvrira son studio et fera la promotion de l’art de la photographie auprès des femmes afin qu’elles se professionnalisent. Kasebier est célèbre pour ses images de la maternité et ses portraits d’Amérindiens.
Céline Lagarde (1873-1961) est française mais travaille aux Etats-Unis où elle développe son art. Ses photos ont un aspect poudré qui est très prisé Outre-Atlantique.
Alice Austen (1866-1952) est une photographe amatrice autodidacte qui s’est appliquée à subvertir les normes de genre de son époque et contribuera à la visibilisation lesbienne de son époque. Elle travaille également pour la ville de New-York en photographiant les très nombreux immigrés qui arrivent quotidiennement à Ellis Island.
 Ann Brigman (1869-1950) est essentiellement connue pour ses nus féminins et même masculins, ce qui fera scandale, disposés dans des paysages naturels. Ses photos contre-culturelles suggèrent la bohème et la libération de la femme.
Ann Brigman (1869-1950) est essentiellement connue pour ses nus féminins et même masculins, ce qui fera scandale, disposés dans des paysages naturels. Ses photos contre-culturelles suggèrent la bohème et la libération de la femme.
III- La nouvelle femme.
Durant l’entre-deux guerres on cherche une nouvelle société. La femme se libère avec ses cheveux courts, l’abandon du corset et son désir de sortir du foyer où elle était cantonnée. Kiki de Montparnasse devient le modèle à suivre. En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis le mouvement des suffragettes bat son plein. Les hommes se sentant menacés prônent un retour à une société traditionnelle comme l’illustre le livre de l’Autrichien Otto Weininger Sexe et caractère. Cependant les femmes poursuivent leur lutte pour l’émancipation en dépit des difficultés. Lucie Moholy (1894-1989) s’inscrit dans le mouvement du Bauhaus, ses clichés sont attribués à son mari et elle devra faire un procès pour obtenir ses droits d’auteur. Autre figure de l’entre-deux guerre, Eva Besnyo, qui étant juive fuira aux Pays-Bas et qui réalisera de nombreux clichés des mouvements féministes hollandais des années 1960.
On peut aussi évoquer Ruth Bernhard (1905-2006) qui réalise de nombreux nus féminins sur le thème des lesbiennes.
IV- Le photojournalisme.
Le photojournalisme se développe dans l’entre-deux guerres grâce aux améliorations techniques qui ont permis d’utiliser les photos dans la presse.
Tina Modotti (1896-1942) est italienne, d’origine très modeste, elle émigre aux Etats-Unis en 1913 où elle rencontre Edward Weston. Elle est d’abord son modèle puis ensemble ils montent un studio photo à Mexico. Il rentre aux Etats-Unis mais elle décide de rester et se lie d’amitié avec Frida Kahlo et Diego Rivera. Elle travaille pour la presse communiste dont le journal El Machete. Lorsque éclate la guerre civile espagnole en 1936, elle s’y rend et rencontre Gerda Taro, autre grande photographe. Tina Modotti utilise la photographie comme moyen de lutte politique. C’est également le cas de Gerda Taro (1910-1937) qui subit l’antisémitisme montant. A Paris, elle rencontre Robert Capa. En 1936 ils partent ensemble couvrir la guerre d’Espagne, elle sera la première femme photographe de guerre à mourir sur le front.
Certaines photographes réalisent un réel travail historique et sociologique. C’est le cas de Dorothea Lange (1895-1965) qui parcourt tous les Etats-Unis avec son mari, mandaté par la Farm Security Administration (FSA) suite à la Grande Dépression pour déterminer les besoins des classes démunies en milieu rural. Ses photos sont si poignantes qu’elle est recrutée en 1935 comme photographe officielle de la FSA. Berenice Abbott (1898-1991) quant à elle est dans un premier temps assistante de Man Ray puis ouvre un studio à Paris. En 1929 elle rentre à New York et photographie tous les changements de la ville avec une recherche sur la modernité. Son travail est un véritable livre d’histoire de New York. Elle écrit également plusieurs ouvrages de formation à la photographie.
Gisèle Freund (1908-2000), elle aussi juive, fuit l’Allemagne et se réfugie à Paris en 1933 puis en Argentine où elle s’intéresse aux problèmes sociétaux et met en parallèle la photographie et la société. Elle revient en France et réalise plusieurs portraits restés célèbres dont celui de Simone de Beauvoir. Elle est pionnière dans le portrait couleur.
 Née en Prusse orientale de parents allemands, Germaine Krull (1897-1985) suit une formation à la photographie photo à Munich en 1916. Égérie de la modernité photographique, elle publie Métal en 1928, qui marque l’entrée du monde industriel et urbain dans l’esthétique de l’Entre 2 guerres. Le portfolio Métal fait l’unanimité dans les milieux avant-gardistes ; avec 64 clichés d’architectures métalliques transformés en compositions abstraites, elle représente la modernité triomphante ; on la surnomme La Walkyrie de fer. Entre 1935 et 1940, elle vit à Monaco ; elle se met au service de propagande de la France libre. Correspondante de guerre, elle suit en 1944, la campagne de France en Alsace et en Allemagne et publie La Bataille d’Alsace. Une rue porte son nom à Paris.
Née en Prusse orientale de parents allemands, Germaine Krull (1897-1985) suit une formation à la photographie photo à Munich en 1916. Égérie de la modernité photographique, elle publie Métal en 1928, qui marque l’entrée du monde industriel et urbain dans l’esthétique de l’Entre 2 guerres. Le portfolio Métal fait l’unanimité dans les milieux avant-gardistes ; avec 64 clichés d’architectures métalliques transformés en compositions abstraites, elle représente la modernité triomphante ; on la surnomme La Walkyrie de fer. Entre 1935 et 1940, elle vit à Monaco ; elle se met au service de propagande de la France libre. Correspondante de guerre, elle suit en 1944, la campagne de France en Alsace et en Allemagne et publie La Bataille d’Alsace. Une rue porte son nom à Paris.
V- La liberté en voyage.
Le voyage a toujours été considéré comme quelque chose de dangereux pour une femme seule. La photographie sera un moyen d’entreprendre de longs voyages et de partir à l’aventure même si dans un premier temps, les femmes partaient souvent accompagnées de leur mari. C’est le cas de Jane Dieulafoy (1851-1916), française appartenant à la haute bourgeoisie toulousaine qui suit son mari polytechnicien dans son travail en Perse. Elle rapporte en 1884 quelques 600 clichés du site de Suse. Soucieuse de ne pas choquer les coutumes et mœurs locales, elle se coupe les cheveux et s’habille comme un homme. De retour en France elle photographie les monuments et publie plusieurs ouvrages.
Helen Messinger Murdoch (1862-1956) est une américaine de Boston qui s’intéresse à la couleur des frères Lumière, l’autochrome. Elle fait plusieurs séjours de formation photographique en Europe puis en 1913 rentre aux Etats-Unis. Elle part après la Grande Guerre faire un tour du monde qui durera deux ans. Nombreuses de ses photos apparaissent dans le National Geographic. Elle fera la première photo autochrome de Boston vue du ciel en 1928.
Ella Maillart (1903-1997) est une suissesse qui s’intéresse à la Russie où elle effectue un reportage en 1930 et publie un livre. Elle rencontre Peter Fleming, reporter pour The Times et espion du MI6 avec qui elle effectue un voyage entre Pékin et Srinagar. En 1937 elle part avec une amie en voiture jusqu’à Kaboul. Elle a un regard analytique qui cherche à montrer tous les points communs de l’humanité.
Hélène Hoppenot (1894-1990) accompagne son mari diplomate et fait de l’anthropologie visuelle. Lotte Erell (1903-1991) est une juive allemande qui accompagne son mari pour faire un reportage au Ghana. Elle publiera un livre sur ce voyage mais il ne sera jamais traduit bien que ce soit un excellent livre ethnographique. La française Anna Conti (1899-1997) est la première photographe à s’intéresser à l’océanographie. Elle n’hésite pas à s’embarquer dans des expéditions difficiles et à travailler dans de rudes conditions. Déjà en 1930 elle tire la sonnette d’alarme sur la surexploitation des mers.
CONCLUSION
Toutes les femmes que nous avons évoquées ont cherché une voie vers la liberté et l’émancipation. Les femmes se sont imposées dans tous les domaines de la photographie : portraits, reportages ethnographiques, publicité, reportages de guerre etc.
Quant à savoir si le sexe influe sur le choix des thèmes ou l’angle d’approche d’un sujet donné, la question reste ouverte car les réponses sont variées et il n’y a pas de consensus.
+ de 1100 textes des conférences du CDI sont disponibles sur le site du CDI de Garches et via le QRCode