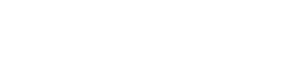DES VARÈGUES AUX GRECS : LA ROUTE DES VIKINGS DE LA BALTIQUE À LA MER NOIRE.
Thèmes: Civilisation, Géographie, Histoire Conférence du mardi 4 mars 2025
DES VARÈGUES AUX GRECS : LA ROUTE DES VIKINGS DE LA BALTIQUE À LA MER NOIRE.
Par Monsieur André PALÉOLOGUE, Docteur en Histoire, expert consultant auprès de l’UNESCO.
Introduction
Pendant plusieurs siècles, l’Empire romain a su développer et exploiter d’un bout à l’autre du continent européen un vaste réseau routier ouvrant des voies (via) prestigieuses telles que l’Egnatia (de Rome à Constantinople), la Diagonalis (de Londres-Londinium à Constantinople), l’Agrippensis alias Francigena (de Cantorbéry à Rome), etc. Le haut Moyen-Âge a enrichi ce réseau avec une via Imperii (de Rome à Stettin), la via Regia (de Kiev à Reims) ainsi que d’un nombre de routes commerciales « spécialisées » dont celle «de l’Ambre» où bien celles que les pèlerins ont pris l’habitude de prendre en direction de Compostelle, Rome ou de Gargano. Moins connues, mais tout aussi fréquentées, les routes « des Varègues aux Grecs » traversaient à l’extrême est de notre continent les territoires situées entre la Baltique et la Mer noire. Pour avoir assuré pendant des siècles la circulation des gens et de leurs marchandises, ces dernières portent aussi la marque de l’impact que les peuples du Nord scandinave (appelées Vikings à l’Ouest et Varègues à l’Est de notre continent) ont pu avoir sur l’histoire européenne.
Les Varègues
Si à l’Ouest, les Vikings se sont fait un renom en tant que « barbares » envahisseurs et pilleurs, il en est autrement à l’Est où, dès le IXe siècle, à la demande des populations slaves, ils fondèrent les premières organisations étatiques Rus’ de Novgorod et de Kiev. Appelés « Varègues » par les Grecs, particulièrement appréciés pour leur loyauté et leur bravoure, les Empereurs byzantins de Constantinople n’ont pas hésité à recruter certains d’entr‘eux pour constituer leur garde rapprochée. Selon la Chronique des temps passés ou la Chronique de Nestor, rédigée vers 1111 (voir la traduction en français de Louis Paris à partir de l’édition impériale de Pétersbourg du Manuscrit de Königsberg, Paris, Heidehof, 1834), c’est aux Varègues, justement, que les Slaves du nord doivent leur conversion au christianisme que l’église, encore indivise au Xe siècle, proposait. Ainsi, les Chrétiens rus’ vont devenir des alliés indispensables des Byzantins pour démanteler l’Etat Khazar au Xe siècle, tempérer l’avancée des Tatares convertis à l’Islam au XIVe et protéger efficacement les voies qui reliaient la Baltique à la Mer noir avant de rejoindre ensuite les routes « de la soie ».
Quelques repères historiques
A l’aube du premier millénaire, sous le règne de Iaroslav « le Sage », le duché Rus’ de Kiev connut une véritable reconnaissance «européenne» du fait aussi que les trois filles de cet illustre descendent des Varègues Riourikides, contractèrent des mariages prestigieux, notamment avec le roi de Norvège, avec celui de Hongrie et, enfin, avec celui des Francs (1054) ! La page inscrite dans l’histoire française par Anne de Kiev – pour un temps régente car épouse du roi Henri et mère de Philippe Ier – est une des plus inattendues et, pourtant, parfaitement compréhensible vu le contexte géopolitique de l’époque.
Les Varègues slavisés et leurs sujets Rus’ à Novgorod, à Kiev et à Moscou devinrent rapidement les maîtres incontestés des routes commerciales qui débutaient soit à Upsala et à Visby (sur l’Ile de Gotland) soit à l’extrémité est du golfe de Finlande à Vyborg. De là, ils pouvaient atteindre Kiev et descendre le fleuve Dniepr jusqu’à Kherson en Tauride (Crimée), avant de longer ou traverser la Mer noire jusqu’à Constantinople. Au XIIIe siècle, la tentative des chevaliers «Porte-Glaive» de l’Ordre Teutonique de s’emparer de ces routes très profitables en direction de la Mer noire, s’est soldée par une cuisante défaite militaire (1242) face à la détermination du prince Alexandre (Nevski) profondément hostile et sourd aux appels visiblement agressifs, des commerçants de la Confédération livonienne et de leurs protecteurs teutoniques.
La route des Varègues aux Grecs à dû subir, également, les conséquences de l’installation durable des Tatares de la Horde d’or en Crimée (XVe siècle) et, enfin, à partir du XVIe siècle, de l’autorité ottomane exercée tout autour de la Mer noire. Pendant plusieurs siècles d’affilée, la « Sublime porte » qui, à partir de 1453, transforma Constantinople en Istanbul, a entretenu un climat de méfiance obligeant le commerce Nord – Sud à l’est de l’Europe à trouver d’autres trajets en direction de la Méditerranée et l’Asie.
Si le tsar Pierre le Grand (1672-1725) prendra finalement le contrôle des routes de la Baltique et intègrera la Russie à la culture occidentale, sous le règne de Catherine la Grande (1729-1796), suite à la conquête de la Crimée, la Russie retrouvera ses débouchés sur la Mer Noire. Ainsi, la vielle route « des Varègues aux Grecs » deviendra pour les Tsars de Russie un rêve d’expansion tenace vers la Méditerranée. Rien ne nous signale aujourd’hui qu’il s’agit juste d’un fantasme géopolitique !
De la Baltique à la Mer noire sur la route «des Varègues aux Grecs»
En quittant Uppsala en Suède et sa cathédrale (pour la construction de laquelle en 1287 fut recruté Etienne de Bonneuil connu comme l’un des meilleurs maçons français de Notre Dame de Paris !), les commerçants varègues faisaient halte dans l’ile de Gotland avant de traverser la Baltique pour atteindre Klaïpeda, Memel et Kaunas dans le duché de Lituanie. Ils se dirigeaient ensuite vers Gomel, Minsk et Kiev pour enfin bénéficier du Dniepr en direction de la Mer noire. Comme ce trajet bien que rapide imposait le déchargement puis la remise des marchandises dans des bateaux à plusieurs reprises, la navigation vers Vyborg dans le golfe de Finlande a été considérée plus sûre voire plus confortable. Par voie d’eau uniquement, marchands et marchandises arrivaient à Staraïa Ladoga et au monastère Saint-Nicolas bâti par Alexandre Nevski après sa victoire sur les Chevaliers teutoniques. D’ici, grâce à un important réseau de rivières et de canaux, on arrivait au Dniepr sans avoir à transborder les marchandises. Nombreuses sont les preuves que les crues, les débits et les courants étaient parfaitement connus et maîtrisés par les Varègues. En guise de témoignages du savoir-faire et de l’esthétique architecturale des Varègues et des Slaves les magnifiques églises en bois se trouvant sur l’ile de Kiji du lac Onega, ouvrent généreusement leurs portes aux touristes qui ont choisi le parcours fluvial Saint Pétersbourg-Moscou.
Ancienne ville-forteresse ralliée à la Ligue commerciale hanséatique, Novgorod s’est fait connaitre aussi comme l’un des centres les plus importants de la chrétienté russe. Tout comme Kiev, elle possède une cathédrale Sainte-Sophie érigée en 1050 par un des fils du «Sage» Iaroslav. Au cours des siècles, les fortification (kremlin) de Novgorod érigées sur la rive gauche de la Volkhov, ont dû faire face à pas moins de 26 attaques suédoises, à 14 sièges livoniens, à 11 expéditions teutoniques, à cinq tentatives de conquête norvégiennes, et à celles des Nazis allemands au XXe siècle. En poursuivant vers le Sud, les escales commerciales ont toujours été Pskov, Smolensk et Vitebsk, cette dernière – lieu de naissance du peintre Chagall et du sculpteur Zadkine. Les embarcations varègues, de même que celles d’aujourd’hui, rencontraient le Dniepr à Moguilev en Galicie. A partir du haut Moyen-Âge, traverser les terres «galiciennes» était l’occasion d’entrer en contact avec une population à forte identité juive parlant l’ashkénaze et fière de ses traditions Hassidim et Loubavitch. Au XXe siècle, les Soviétiques, de même que les Nazis, ont essayé d’éradiquer cette culture qui, à ce jour, est en voie de réhabilitation.
Une fois sur le Dniepr, les embarcations des Varègues comme celles d’aujourd’hui traversent l’Ukraine et ce qu’on a pu appeler au temps de tsars la Malo et la Novorossiya (la Petite et la Nouvelle Russie), régions peuplées de Russes arrivés de tous les coins de l’Empire, d’Allemands amenés par Catherine la Grande au XVIIIe siècle, de Cosaques, de Grecs, de Tatares, etc.
Nécropole des premiers souverains de la «Sainte Russie», la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev a gardé en grande partie ses mosaïques byzantines. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, ses façades anciennes reçurent un habit baroque «à l’occidentale» signe d’un radical changement du goût et d’une «modernisation» pas toujours consentie de l’Eglise russe traditionnelle.
En poursuivant vers le Sud sur le territoire des Cosaques, les marchands atteignaient Zaporojie, depuis toujours point stratégique situé à seulement 200 Km de la Mer. C’est bien là que la retenue d’eau d’un gigantesque barrage de l’époque soviétique est destiné à faire tourner les turbines d’une très importante centrale hydro-électrique. Plus au sud encore, à l’embouchure du Dniepr ou bien aux portes de la Crimée, les Varègues, et avant eux les Grecs, avaient aménagé pour leurs bateaux plusieurs points d’amarrage. En effet, il fallait ici passer de l’eau douce à la navigation en eaux salées. Lorsque Catherine la Grande repoussa les Ottomans hors de Crimée, elle fit installer aux mêmes emplacements les bases premières de la puissance navale militaire russe. Toujours ici, on décidait jadis, soit d’emprunter la route qui longe la côte ouest de la Mer noire soit le cabotage. D’une manière ou d’une autre, une halte était à prévoir à Odessa, antique port grec qui, à ce jour, est marqué de la «modernité française» que le Duc de Richelieu et de Fronsac (1766-1822) a promu lorsqu’il fut investi Gouverneur de toute la Novorossiya. Rien d’étonnant que sa statue puisse être admirée en haut du monumental escalier filmé dans les années 1920 par Eisenstein.
Avant d’arriver à Constantinople, les Varègues ayant choisi la voie de terre, faisaient escale en Bessarabie, autrement dit dans l’ancienne principauté de Moldavie. Aussi, plus au sud, en Valachie, là où fut découvert à la fin du siècle dernier un remarquable site religieux rupestre qui garde gravés sur ses parois des Tridents, symboles bien reconnaissables des marins Varègues et Vikings. Enfin, au pieds de la chaine montagneuse des Balkans qui achève son trajet en Mer noire, les galères d’antan s’arrêtaient à Messembrie (Nessebar) où les touristes d’aujourd’hui peuvent admirer les ruines de son prestigieux passé byzantin. Toujours dans les terres, mais pas loin de la côte, se trouvait, jadis, le point de rencontre et de jonction des via Diagonalis et Egnatia. A quelques encablures encore, sur la côte «européenne» du Bosphore, les défenseurs varègues des Empereurs byzantins ont installé de nombreuses fortifications. Raison pour laquelle, lors de la prise de Constantinople en 1453, les Ottomans ont du s’emparer en premier de ces remparts stratégiques magnifiquement bien conçus par le génie varègue.
CONCLUSION
La route des Varègues aux Grecs a permis le développement du commerce et des échanges à l’est de l’Europe et la naissance d’un essor économique et culturel important dans l’espace situé dans l’Ouest immédiat de la Russie actuelle : l’organisation étatique des Rus’ de Kiev, leur conversion au christianisme, l’écriture (alphabet cyrillique), l’art de l’icône, etc. Ceci explique aussi qu’en dépit de toutes les vicissitudes de l’histoire européenne, les Russes sont restés fidèles aux rituels orthodoxes, prouvant ainsi leur fort attachement pour l’Empire byzantin. A tel point qu’encore à ce jour, certains Russes aiment faire entendre d’inutiles revendications.
+ de 1100 textes des conférences du CDI sont disponibles sur le site du CDI de Garches et via le QRCode