LES CHOIX D’UN HOMME ; REVES ET REALITES
Thèmes: Médecine, Sciences
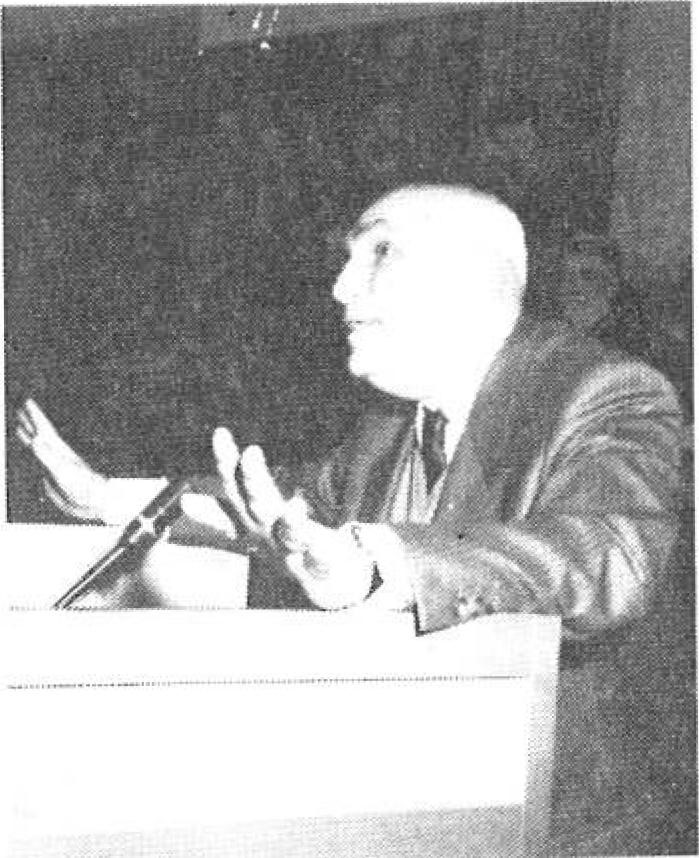 |
LES CHOIX D’UN HOMME ; REVES ET REALITES Professeur Albert Delaunay Mardi 4 octobre 1988 |
Le Docteur Albert Delaunay, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur, a traité devant une assemblée toujours fidèle, des « choix d’un homme ; rêves et réalités ».
J’ai écouté avec une particulière attention les paroles que vient de prononcer Monsieur Bodin et je le remercie de les avoir dites car mon entrée en matière se trouvera beaucoup facilitée.
Bien sûr, parce que, chemin faisant, il n’a pu que toucher, par ses éloges, ma vanité mais aussi, pour une autre raison qu’il me faut expliquer. Vous êtes venus dans cette salle pour m’entendre, une fois de plus, faire une conférence. Mais celle-ci a ceci de particulier qu’elle porte un titre singulier
« Les choix d’un homme ; rêves et réalités ».
Que peut recouvrir un tel titre ? Il n’est pas possible qu’au moins certains d’entre vous ne se soient pas posés, ne serait-ce qu’une seconde, la question. De fait, il n’est pas clair. Je serais même tenté de vous féliciter pour m’avoir, somme toute, fait confiance.
Et pourtant, je peux dire que le titre en question m’est venu spontanément, et même brusquement. C’était un matin de juillet dernier. Notre amie, Madame Eymar m’avait appelé au téléphone et elle me demandait si j’accepterais de faire, au mois d’octobre suivant, une conférence au C.D.I. Sans réfléchir, je répondis oui.
- Vous pouvez me proposer un sujet ?
- Choisissez celui qui vous plaira.
On ne pouvait être plus aimable. J’eus alors un moment d’hésitation. Comme il devait s’agir d’une conférence d’ouverture, je pensais qu’il serait bon de retenir un sujet de portée générale et c’est alors que j’ai lancé, comme à la volée, le titre que vous connaissez.
Madame Eymar ne souleva aucune objection. Elle me remerciait et raccrochait son appareil. C’est alors que, seul avec moi-même, je commençais à réfléchir un peu sérieusement et je me demandais : « Mais de quoi vais-je parler ? ».
J’avoue que je n’hésitais pas longtemps. Au fond, il n’y avait pas de véritable problème. Sous un tel titre, on pouvait tout mettre puisqu’en somme, j’avais accepté de dire comment un homme peut réagir devant les problèmes que la vie ne cesse de lui poser. Réflexes et réflexions, je crois me souvenir que c’est là le titre d’un livre de Paul Morand publié avant guerre.
Pourtant, ma réflexion se prolongeant un peu, tout ne me paraissait pas encore clair. Loin de là même. Je sentais que je risquais fort de me trouver devant vous dans une situation plutôt inconfortable. Par ce que j’aurai à dire, je me trouverai forcément conduit à parler de moi-même. Or le « moi », a dit Pascal, c’est toujours haïssable. Heureusement, un moyen m’apparut qui me permettrait de tourner la difficulté.
Cela est vrai, j’aurai de temps à autre l’obligation de me mettre en avant, de dire « je », mais après tout, je ne suis qu’un homme comme les autres et même, si ce que j’ai connu, tous ne l’ont pas connu, en fait beaucoup de problèmes humains sont les mêmes pour tous. Donc, d’une expérience personnelle, on peut tirer sans trop de peine des observations de portée générale.
Sur ce point tout au moins, je finissais par me sentir rassuré. Mais, par un nouveau pas en avant, je finissais par remarquer que ma justification n’était pas parfaite. Notamment, une nouvelle question venait me tarauder : « Pourquoi faire une conférence — qui est, authentiquement, une « première » aujourd’hui et ici même? Hic et nunc, comme disaient les Latins. Mais les dieux m’étant décidément favorables, cette fois encore, les réponses venaient assez vite.
Pourquoi maintenant ? Regardez-moi. Me voici devant vous, homme âgé aux cheveux tout à fait blancs, Littré a dit quelque part que la vieillesse commençait à soixante ans. Vous vous rendez bien compte qu’il y a déjà quelque temps que j’ai franchi cette barrière. La chose est grave, bien sûr, et je n’ignore pas que la mode est passée où l’on recommandait d’entendre les vieillards. Malgré tout cela, me ferez-vous l’amitié, l’espace d’une heure, d’écouter mes propos ?
Maintenant pourquoi ici ? Cette fois, aucun scrupule ne vint m’arrêter. Mais, tout simplement parce que je me compte parmi les plus anciens membres du C.D.I. Et, si j’ose dire, plus encore, parce qu’il me semble que j’ai été, que je reste, un vrai Garchois. Et c’est précisément à ce sujet que Monsieur Bodin a dit ce qu’il fallait dire, facilitant d’autant la tâche qui m’était impartie.
J’aurai vécu parmi vous de 1939 à 1980. Certes, ma famille et moi-même, nous n’habitions pas exactement Garches. Mais, si nous habitions administrativement Vaucresson, c’était à deux pas d’ici sur le plateau qui domine, à l’ouest, votre cité, cette proximité faisait que nos commerçants étaient les vôtres. Deux fois par semaine, ma femme descendait au marché de la place de l’Eglise. Nos enfants — cher Monsieur Brichard — fréquentaient les écoles de Monsieur Plé, votre prédécesseur. Et naturellement, c’était le cher abbé Rodhain — que beaucoup d’entre vous ont connu — qui avait été chargé de leur apprendre à croire en Dieu.
En somme, tout se passe aujourd’hui comme si un Garchois venait faire une conférence publique devant ses véritables concitoyens. Je viens de rappeler le souvenir de l’abbé Rodhain ; j’ai l’impression que je vais — un peu — me confesser à vous. Reste à savoir si je mériterai votre absolution. Nous le verrons bien.
I – Le choix d’un métier –
J’ai vingt-cinq ans et, depuis deux décennies, je vis à Nantes (aujourd’hui en Loire atlantique). C’est dans cette ville que j’ai fait toutes mes études médicales.
Comme pour chacun de nous, la possibilité ne m’avait pas été donnée de choisir ma famille. Mais il faut ajouter que je n’avais pas davantage choisi de faire des études médicales. Non, je n’avais pas la vocation : Mon père était mort prématurément. Ma mère était une personne autoritaire qui savait, à la perfection, imposer sa volonté. Elle avait décidé que je serais médecin, comme mon frère aîné. Je n’avais pu que m’incliner. Mais, en 1936, mes études professionnelles étaient sur le point de prendre fin. Qu’allais-je faire ? Cette fois, heureusement, c’est à moi seul que le choix appartenait.
Nous avons ainsi rejoint le titre de mon exposé : « Les choix d’un homme ».
Sans doute, j’aurais pu devenir un bon praticien à Nantes même ou dans une commune environnante. J’aurais pu aussi, comme certains me le conseillaient, fonder un laboratoire d’analyses comme la mode tendait alors à se répandre en France. Je n’avais pas caché que je trouvais un certain plaisir à manipuler tubes et pipettes. Mais, décidément, rien de tout cela ne me tentait. Perplexité
Cependant, un facteur nouveau, depuis quelque temps, s’était subrepticement glissé en moi. Un jour, par hasard, j’avais été conduit à lire les deux premiers livres d’un auteur qui jouissait alors d’une grande réputation : il s’agit d‘André Maurois. Laissez-moi le plaisir de rappeler leurs titres : Les Silences du Colonel Bramble et Les Discours du Docteur O’Grady. J’avais été réellement charmé par la fluidité du style et l’esprit qui se dégageait de chaque page.
Cela fait que, sans attendre, je m’étais mis à lire toutes les biographies, puis tous les livres, du même écrivain. Le charme durait. J’apprenais beaucoup de choses. Je me mettais aussi à réfléchir.
Quand le moment est venu pour un homme de se lancer, à ses risques et périls, dans la vie, ce qu’il demande d’abord à son métier — car il faut bien travailler — c’est de lui procurer des moyens de vivre agréablement et d’élever une famille, c’est de lui permettre de prendre des vacances à la mer ou à la montagne. Tout cela est parfaitement raisonnable, honorable même, et il faut avouer qu’il s’agit certainement là du cas le plus courant.
Mais, par mes réflexions de l’époque, j’étais aussi conduit à imaginer autre chose. Moins tenté sans doute que la moyenne par les seules satisfactions que je viens d’évoquer, je pensais qu’après tout, jouir d’une fortune rassurante n’est peut-être pas le premier des avantages sur cette terre, qu’il y a aussi de purs plaisirs de l’esprit. Or c’est cela précisément que mon commerce avec André Maurois me faisait sentir.
Puis-je dire qu’en cela il se montrait mon Maître à penser ? Ce serait sans doute s’avancer. H me semblait tout de même que j’aurais bien voulu devenir ce qu’il était lui-même. Essentiellement, un esprit curieux et cultivé et aussi un homme capable à la fois d’instruire les autres, tout en les intéressant. Seulement, il y avait une difficulté : je n’avais pas réellement, par naissance ou par travail, un talent littéraire. En quoi ma formation médicale pouvait-elle me conduire à réaliser, dans le milieu où je vivrais et à mon niveau, ce que des désirs confus semblaient indiquer en moi ? Je ne savais pas encore que le hasard est le plus grand des Maîtres.
Un jour, et absolument par hasard, j’apprenais qu’à Paris, dans le cadre de l’Institut Pasteur, il y avait un hôpital. Très vite, j’appris que, dans cet hôpital, il y avait des internes, qu’ils étaient nommés, non sur concours mais au choix. J’osais faire une demande pour devenir l’un d’eux. Des personnes bien placées apportèrent leurs recommandations. Un mois plus tard exactement — ô chance, quand tu acceptes de nous sourire : —j’étais nommé à la place que je convoitais. Je quittais prématurément l’internat de Nantes. J’étais devenu parisien et … pastorien.
Je m’arrêterai ici une seconde. « Le choix d’un homme ». Sans doute, Mesdames et Messieurs, votre propre histoire diffère-t-elle de la mienne. Vos goûts, au moment du choix, étaient sans doute différents des miens. Les occasions, les facilités, changent. Après tout, il y a tant de routes possibles. Quoiqu’il en soit, il reste tout de même à peu près certain que, le moment venu, ce sont les circonstances, beaucoup plus que notre volonté, qui décident ce que sera notre choix. Soutenir que l’on choisit sa profession, hum… Choisit-on même, parmi toutes les femmes, celle qui sera la nôtre. Un humoriste a même pu dire que toutes nos plus grandes décisions ne sont jamais prises qu’à une voix de majorité
Mais ce n’est pas obligatoirement un mal
II – Les chemins de la connaissance –
- La découverte des sulfamides.
Nous voici en mars 1936 et je vous rappelle que, désormais je suis interne à l’Hôpital Pasteur, rue de Vaugirard à Paris.
Je passe les premiers mois dans les services de la Consultation puis, en octobre de la même année, je suis promu interne dans le Pavillon Emile Roux. Deux Pavillons composaient alors, pour l’essentiel, l’Hôpital Pasteur et tous deux étaient réservés, presque exclusivement, au traitement des maladies infectieuses : diphtérie, rougeole, scarlatine, fièvre typhoïde, méningite, etc. En ce temps-là, ces maladies étaient encore très fréquentes et, le plus souvent, les deux Pavillons affichaient complets. Le souvenir des grandes épidémies ne s’était pas éteint. Maladies fréquentes, mais aussi graves.
Certes, en ce domaine, la médecine n’était plus démunie comme elle l’avait été si longtemps. Les savants — souvent, du reste, des pastoriens — avaient déjà mis au point sérums et vaccins. Et contre quelques maladies provoquées par de gros parasites, comme la syphilis ou le paludisme, on pouvait aussi se servir de certains produits chimiques. En revanche, toute chimiothérapie demeurait inefficace quand il s’agissait d’affections provoquées par des bactéries ou des virus.
Or, en 1935, donc quand j’étais jeune nantais, une heureuse surprise s’était produite. Un médecin allemand, du nom de G. Domagk, avait pu annoncer que ses collaborateurs chimistes avaient préparé une substance particulière indiscutablement active contre une bactérie particulièrement redoutable : le Streptocoque. Et c’était vrai (il devait du reste recevoir le Prix Nobel pour sa découverte). Une affection se montrait particulièrement sensible : l’érysipèle. C’était une effectivement merveille que de voir fondre, sous son action, la laide plaque rouge que le germe provoque. Mais tout n’était pas parfait. Le produit — appelé prontosil en Allemagne, rubiazol en France — n’agissait pas dans tous les cas et, de toute manière, en raison de sa toxicité, il était d’un maniement difficile. Cela fait que, sans plus attendre, beaucoup de chimistes de synthèse s’étaient mis au travail pour lui trouver des succédanés préférables.
En mai 1937, entrait au Pavillon II, là où j’étais interne, un jeune garçon atteint de méningite. Il n’avait pas 10 ans. 3e parvenais rapidement à identifier le germe coupable, c’était précisément un streptocoque, mais d’une telle virulence que la mort de l’enfant semblait inéluctable. Que faire ? Apparemment rien. Et pourtant… Nous savions, mon maître le Docteur René Martin et moi-même, que, tout près de notre Pavillon, quatre chercheurs (J. et Th. Tréfouë1, Nitti et Bovet), chimistes de synthèse par métier, étaient eux-mêmes à la recherche de produits antibactériens nouveaux.
Nous avions même entendu dire qu’entre leurs mains, expérimenté sur la souris, le para-amino-phénylsulfamide (ou 1162 F) donnait de bons résultats. Je n’hésitais pas. J’allais demander un peu de leur produit déjà mis en comprimés. Quelques-uns de ces comprimés furent donnés à l’enfant. Miracle. Oui, miracle… Quarante-huit heures plus tard, la fièvre était tombée et l’enfant sortait, guéri, de l’hôpital.
Heure étoilée de mon existence ? Oui, une des grandes heures. La sulfamidothérapie chez l’homme était née, et née entre nos mains. Les confirmations ne tardaient pas à venir, en France d’abord puis à l’étranger. Prontosil et rubiazol perdaient de leur importance (le 1162 F leur est d’ailleurs apparenté), d’autres produits de synthèse voyaient le jour un peu plus tard, actifs eux, non seulement sur le streptocoque mais aussi sur d’autres bactéries. Il existait désormais, à côté des vaccins et des sérums, une nouvelle arme précieuse en thérapeutique anti-infectieuse.
Mon choix de l’Hôpital Pasteur avait donc été un bon choix. Mais, en l’occurrence, la chance, encore elle, avait joué un rôle primordial. Je décidais alors de quitter l’Hôpital pour entrer à l’Institut même. Je me souviens d’un roman américain où le héros, le soir de sa soutenance de thèse, dit, en levant les yeux au ciel : « Thanks God, I am a doctor ». Je pouvais dire de mon côté : « Merci, mon Dieu, je suis un vrai pastorien ».
Cependant, en tous points du monde, la belle histoire médicale continuait. En France, au moment même de la Libération, les Français apprenaient la découverte d’un nouvel agent encore plus actif que les sulfamides : la pénicilline puis, année après année, la liste des antibiotiques ne cessait de s’allonger. Désormais, on ne se trouvait plus vraiment dépourvu devant une bactérie pathogène. N’oublions pas tout de même qu’il y a encore des formes bactériennes contre lesquelles on ne peut rien. Et puis il y a le domaine des agents viraux qui, lui, s’étend chaque jour davantage et contre lesquels on ne peut guère compter sur des produits chimiques.
La pénicilline avait été découverte par un biologiste anglais : Alexander Fleming en 1928 mais, pour différentes raisons, ce n’est que pendant la dernière guerre que son action chez l’homme avait pu être démontrée. Un dimanche de 1956, André Maurois — nous y revenons —voyait entrer, dans son bureau de Neuilly, une femme en deuil : c’était Lady Fleming, veuve depuis peu. Elle venait demander à l’académicien d’écrire la biographie de son illustre mari. Maurois avait tendance à se récuser puis il revenait sur sa réponse. Peu de temps après mon entrée à l’Hôpital Pasteur, tout naturellement curieux de connaître l’homme après l’auteur, j’étais allé lui rendre visite. Bien vite, une amitié était née entre nous et, sans être intimes, nous nous rencontrions assez souvent. Il pensait alors à me demander si, dans le cas d’une réponse finalement positive à Lady Fleming, il pourrait compter sur mon aide. Comment aurais-je pu refuser ? Le livre était en grande partie écrit en ma présence dans la propriété périgourdine de Maurois à Essendiéras. Vacances d’un été ? Oui et non. Pour le plaisir en effet, ces vacances devaient se renouveler, chaque été, de 1956 à 1967. 3e me trouvais là-bas en août. Un mois plus tard, mon grand ami était mort.
- Les développements de l’Immunologie.
Je voudrais maintenant, et toujours en me servant de mes souvenirs personnels, vous raconter une autre histoire, histoire d’une branche particulière de la Biologie que l’on appelle communément Immunologie. Il s’agira toujours de réflexes et de réflexions mais ceux d’hommes chargés par leur profession de nous faire mieux connaître les procédés de la nature.
L’Immunologie, c’est la Science qui se préoccupe de découvrir comment, dans les conditions naturelles, un organisme — le vôtre, le mien — arrive à se défendre contre les agressions qu’il reçoit de l’extérieur, en d’autres termes, comment un organisme parvient à sauvegarder, tant bien que mal, de la naissance à la mort, son intégrité. En ce domaine, un pas immense a été fait dans nos connaissances grâce à l’étude de ce qu’on appelle les réactions inflammatoires.
Un cas simple ? Le voici. Un jour, notre maladresse fait que nous nous entaillons le bout d’un doigt. La blessure s’infecte, et se forme localement un abcès. Vous maudissez le sort. Mais vous avez tort. Bien vite, une légion de cellules circulant dans votre sang quitte ce milieu pour venir se grouper autour de la blessure et un étrange combat prend naissance entre ces cellules et les microbes infectants. Dans l’immense majorité des cas, la victoire reviendra à vos cellules.
Les ennemis disparaîtront et votre doigt recouvrera son intégrité. La réaction bénéfique que je viens de vous décrire a été découverte puis étudiée aux environs de 1890 par un illustre pastorien d’origine russe, Elie Metchnikoff. A coup sûr, grandissime découverte. Metchnikoff a nommé phagocytes ces cellules utiles.
H est cependant, d’autres cas où le bénéfice apporté par l’intervention cellulaire apparaît moins grand. Il s’agit, cette fois, de ces maladies dont, un jour ou l’autre, nous avons tous subi les attaques et connues sous le nom de maladies allergiques ou de rhumatismes.
Alors, il y a aussi intervention des phagocytes mais, encore aujourd’hui, on ne voit pas très bien ce qui fait qu’en un point donné se produit une telle réaction avec sa conséquence sensible : la douleur.
Ce n’est pas tout. Un troisième cas est à considérer dans l’ordre d’idées qui nous retient en ce moment, et c’est celui des greffes. Précisément, parce que l’organisme entend à tout prix conserver son intégrité, ou, comme les biologistes ont pris l’habitude de le dire, son « soi », toute hétérogreffe — c’est à dire la greffe d’un tissu venant d’un sujet A et porté sur un sujet B — ne manque jamais de mourir et de disparaître. Ce qui n’arrive pas quand il s’agit simplement du transport d’un tissu d’un point à un autre du même organisme.
Pendant la dernière guerre, en Angleterre, bien des aviateurs avaient été victimes de grandes blessures cutanées. Dans le cas présent, la guérison aurait été certainement hâtée par l’emploi de greffes. Mais on se heurtait à l’impossibilité des hétérogreffes. Le gouvernement anglais (..réflexe) demandait donc alors à quelques éminents spécialistes d’entreprendre des recherches qui expliqueraient le mécanisme de tels « rejets ». Ils réussissaient. Cette fois, l’accent était mis sur l’action primordiale de certaines substances appelées anticorps que l’organisme avait fabriquées en réaction à la présence d’un tissu étranger. Un grand nom à citer ici, car sa recherche fut le fruit d’une profonde réflexion, c’est Medawar.
Qu’il s’agisse d’allergies, de rhumatismes ou d’hétérogreffes, il est facile de se rendre compte que, dans toutes ces éventualités, si différentes qu’elles apparaissent à première vue, des réactions inflammatoires, au lieu d’être utiles comme dans le premier cas envisagé plus haut, peuvent se montrer nettement défavorables. Que peut-on faire alors pour freiner leur évolution ?
Une réponse venait, éclatante, en 1949, avec la découverte, par le médecin américain Hench, du premier produit puissamment doué d’une action anti-inflammatoire. Ce produit était appelé cortisone. Vous en avez tous entendu parler car, bien qu’elle ne soit pas sans défaut, cette hormone est devenue de nos jours un des médicaments le, plus prescrits. Il est amusant, du reste, de remarquer que, sans le savoir, nous disposions déjà, depuis la première guerre mondiale, d’un autre anti-inflammatoire actif. Je veux parler tout simplement de la si banale aspirine.
La suite de l’histoire ? Vous la connaissez. C’est la découverte de nouveaux anti-inflammatoires (le plus intéressant étant peut-être la ciclosporine). C’est la pratique de greffes d’organes entiers chez l’animal puis chez l’homme. Rappelez-vous l’émotion causée par le médecin Barnard avec la première greffe du cœur humain. Auparavant, il y avait eu en France et aux Etats-Unis les hétérogreffes de rein humain. Aujourd’hui, le domaine des greffes, en chirurgie, est devenu immense. Et de même, on sait, de moins en moins mal, atténuer les effets d’allergies ou de rhumatismes. Utilisation de produits chimiques pour nous aider ? Sans doute, mais il y eut aussi une découverte française (Dausset) d’un genre différent, la découverte des groupes leucocytaires, découverte qui a permis, non seulement de comprendre ce qui se passe en profondeur dans nos tissus mais aussi, pour ce qui est des greffes, de mieux apparier donneurs et receveurs.
Cela dit, je reviendrai un instant au détestable « je ». Beaucoup d’eau a passé sous les ponts de Paris depuis le moment où le jeune interne dont je vous ai parlé s’occupait de la sulfamidothérapie à l’Hôpital Pasteur. « Les choix d’un homme ; Rêves et réalités ». Avais-je, en 1936, fait un bon choix ? N’avais-je pas eu l’occasion de vivre depuis lors, en esprit, intensément ? Qui oserait dire le contraire ? Rêve ou réalité ? Eh bien non, ce n’était pas un rêve. Sans doute, dans l’immense majorité des cas, je n’avais pas été à l’avant-scène. Mais, par ma situation de pastorien, j’avais pu connaître personnellement les grands auteurs. J’avais pu les suivre dans leur marche au progrès.
Mais je suis loin d’avoir encore tout dit. L’Immunologie continue sa marche en avant et cette science que j’ai encore connue modeste, elle est dorénavant une des premières. Je vous raconterai une dernière histoire la concernant. A l’origine (aux environs de 1960), une simple expérience faite en Australie par un certain Miller. Un jour, celui-ci a la curieuse idée de priver, dès leur naissance, des souriceaux, d’une glande que tous les mammifères portent sur le devant du cou : le thymus. L’opération réussit. Les animaux opérés survivent et, apparemment, ils ne sont pas différents des souris normales. Ils le sont pourtant. Leurs réactions sont autres. Ainsi, un fragment de peau de souris noire normale, greffé sur une souris au pelage blanc mais qui a été privée de thymus, « prend ». Je dirai à ce sujet que, toute ma vie, je reverrai Miller présenter, dans le grand amphithéâtre de l’Institut Pasteur, ses curieux animaux. Une souris toute blanche mais avec, sur sa peau, une large tache noire. Il avait le droit de dire qu’il avait trouvé le moyen de rendre enfin possibles des hétérogreffes. Sans doute par un moyen tout à fait inutilisable chez l’homme. Mais, sur le plan général, quel progrès dans nos connaissances
Et ce qui frappe profondément, même un spécialiste comme celui que je suis devenu au laboratoire, c’est que tout, dans cette direction, continue de progresser. Si j’avais le temps, je vous parlerai maintenant de cellules différentes des phagocytes mais au rôle également capital dans notre organisme : les lymphocytes. Je vous parlerai aussi de curieux « messagers » comme les interférons ou les interleukines qui seront peut-être demain nos meilleurs moyens de lutte contre les cancers. Mais nous serions encore là à l’heure du dîner. II est temps pour moi, de passer à un autre chapitre. Je demeurerai dans l’immense champ de la Biologie mais il s’agira, cette fois, d’un autre ensemble qui s’appelle Génétique. Ce que j’ai ici à vous présenter, mais c’est tout simplement l’histoire d’une révolution, celle apportée par le passage de la Biologie classique à la nouvelle Biologie ou Biologie moléculaire.
- Naissance de la Biologie moléculaire.
Tout organisme vivant, du plus simple au plus compliqué, se compose de petites logettes appelées cellules. Il y a 150 ans que l’utilisation du microscope nous a appris cela. Simplement, une bactérie se compose d’une cellule, et un organisme humain en compte, lui, des milliards.
La suite des recherches devait nous montrer que toute cellule se compose en fait de deux parties. L’une est le protoplasme, siège des propriétés vitales de la cellule, et, au centre, le noyau avec ses constituants bien visibles au moment des divisions cellulaires : les chromosomes. Nouveau pas en avant : vers la fin du XIXème siècle, on apprenait que les chromosomes eux-mêmes ne sont pas des constituants simples mais qu’ils sont formés par une chaîne de gènes. Qu’est-ce qu’un gène (mot proposé vers 1900) ? C’est un élément du chromosome qui conditionne la transmission et la manifestation d’un caractère héréditaire bien déterminé.
Nous voici maintenant au milieu du XXème siècle. Arrêtons-nous ici un instant et une nouvelle fois — vous me le permettez, n’est-ce pas, puisque je vous ai bien dit en commençant que ma conférence serait aussi une sorte de confession — laissez-moi évoquer un souvenir personnel. 1941-1944 : Garches vit sous l’occupation allemande et, à l’Institut Pasteur, je travaillais avec le plus aimé des maîtres : André Boivin. Alors, nos moyens de recherche étaient fort limités : nous manquions à peu près de tout : animaux, appareils de mesure, produits chimiques. Mais je continuais à m’instruire. C’était en tous sujets, mais peut-être que celui qui revenait le plus souvent dans les exposés d’André Boivin concernait ces fameux gènes.
Il s’agissait, manifestement, de pièces maîtresses mais alors ils n’étaient guère plus qu’un mot. Notamment, on ignorait de quelle matière chimique particulière ils pouvaient être faits et comment ils pouvaient exercer leurs rôles, des rôles réellement fondamentaux. Mon maître ne le savait pas plus que les autres mais son esprit, déjà encyclopédique, était aussi d’une grande finesse et il avait le don des visions prophétiques. « Pour moi, me disait-il, il ne peut s’agir que de l’acide désoxyribonucléique », substance isolée pour la première fois en Suisse un peu avant 1900 mais dont l’étude avait jusqu’alors été tout à fait négligée.
Maintenant, c’est un véritable film que je vais avoir à projeter devant vous.
- Septembre 1944 : un article de la revue Journal of experimental Medecine nous apprend que des savants américains viennent enfin d’élucider la chimie du gène : il s’agit bien de l’acide désoxyribonucléique. Mon maître avait raison.
- 1953-1960. Toute une série d’admirables découvertes (faites essentiellement sur des bactéries) nous révèle ce qu’est la structure d’un gène. Dès lors, il devient facile d’imaginer comment il peut exercer des fonctions jusqu’alors incompréhensibles. Les étudiants auront à apprendre désormais ce qu’il faut entendre par Code des protéines.
- On parvient à isoler certains gènes aux fonctions caractéristiques. Plus étonnant encore, on parvient à greffer un gène isolé d’un organisme dans le noyau d’un autre organisme non apparenté par nature. Il confère ainsi à la cellule une fonction que, naturellement, elle n’avait pas. En somme, on a créé un être vivant que Dieu lui-même n’avait pas prévu. Mais, alors, on prend peur. De telles manifestations sont-elles sans risques ? Un colloque particulier est organisé à Asilomar (en 1971) sur la côte pacifique des Etats-Unis. Les biologistes réunis finissent par s’entendre. Ceci sera permis, cela non. En fait, toutes leurs décisions ne seront en rien respectées.
- Les expériences se multiplient au contraire dans les laboratoires du monde entier. Les industriels prennent la relève. Une nouvelle ère commence, qui est celle des Des simples bactéries on est passé à la manipulation d’êtres vivants, animaux et végétaux, de plus en plus complexes. A côté du monde vivant naturel, c’est tout un monde vivant artificiel qui se met en place. Ces nouveaux êtres, vous les rencontrerez chez votre fleuriste ou à la ferme. Reste l’homme…
- En m’écoutant, vous êtes un peu troublé ? Mais je le crois volontiers. Je le suis moi-même. Car, tout simplement, une nouvelle question vient de se poser à nous et celle-ci a quelque chose d’assez terrifiant. Qui est l’homme ?
Ill – Qui est l’Homme ?
La question est tellement vaste que je ne peux offrir — dans ce texte — qu’un bref résumé.
D’où vient la vie ? Comment se sont formés les êtres vivants qui se sont succédés depuis des milliards d’années à la surface de notre globe ? On ne le sait pas. Action d’une puissance supérieure, rôle fatal du hasard ? On ne le sait pas. Alors l’homme ?
Sur ce point, nous pouvons entendre deux explications. Pour les uns, l’acteur c’est Dieu, pour les autres, le hasard.
Le judéochristianisme nous apprend que le Dieu que nous respectons a créé l’homme à son image. Dans ces conditions, est-il permis à un croyant de modifier la créature ? Question embarrassante, en particulier pour le Saint Père de Rome, car, selon les cas, il sera conduit à dire qu’il y a des initiatives satisfaisantes et d’autres blâmables. Il a parfaitement le droit de parler ainsi mais nous savons aussi que, même dans le milieu catholique, ses impératifs ne sont pas toujours suivis.
Reste le non croyant.
A lui, comment se pose la même question : peut-on modifier l’homme, dans sa genèse, dans son fonctionnement naturel, dans ses pensées même ?
En principe, on serait tenté de répondre oui. Après tout, biologiquement, l’homme —en dehors de son activité cérébrale — n’apparaît guère différent des autres mammifères les plus évolués. Seulement voilà, nous sommes ainsi faits que nous avons cru bon d’élever dans le passé des frontières éthiques.
Et, pour d’autres raisons sans doute mais tout de même de la même façon, nous nous retrouvons dans la même situation que l’évêque de Rome. Il suffit de prendre un seul cas par exemple : la fécondation in vitro. Faut-il se réjouir de cette possibilité, faut-il la redouter. Comment répondre ? En fait il ne peut y avoir une unique réponse car l’homme, par son action sur lui-même, et sur son environnement, ne cesse de se modifier. Il est un complexe de nature et de culture. L’homo biologicus ne paraît guère changer. Mais les cultures, elles, fruits de nos découvertes et de nos raisonnements, ne cessent, elles de se transformer.
Alors, quelle conclusion ? Autant dire — et la chose est assez grave en soi — que nous ne le savons pas. Les choix d’un homme ? Ici, on se heurte à une sorte de limite.
J’arrêterai ici la confession promise. Je ne sais si, comme je l’avais espéré, vous voudrez bien me donner votre absolution. Je n’en suis plus si sûr !
Pardonnez-moi.
Un autre conférencier viendra peut-être apporter — enfin — un vrai faisceau de lumière.
Mais il faudra attendre encore quelques années et, ce qui est certain, c’est que ce conférencier, ce ne sera pas moi !
ANNEXE
REFLEXION D’UN PASTORIEN APRES
LES CONFERENCES DU PROFESSEUR DELAUNAY
René PERY
Heureux d’avoir pu contribuer pour ma modeste part aux travaux de l’Institut, fier d’avoir côtoyé les éminents savants qui ont étendu son rayonnement, et surtout toujours imprégné de l’enseignement et de l’exemple de Pasteur, je vous demande d’accueillir avec bienveillance les remarques suivantes dans le fascicule de notre C.D.I.
La profondeur psychologique et l’intuition scientifique de Pasteur ont devancé les travaux et les découvertes, non seulement de sa propre science, la Chimie, mais de celle qui aboutirait à la synthèse des nucléotides, voire de celle qui découvrirait les particules subatomiques.
Il étudiait l’hémiédrie des cristaux de paratartrates lorsqu’il eut l’idée, prenant un à un ces cristaux, de classer séparément les hémiédriques de droite de ceux de gauche. Il pensait que, quand il observerait séparément leurs dissolutions dans l’appareil de polarisation, les deux hémiédries différentes donneraient des déviations inverses puisque, prélevant un poids égal de chacun des deux sortes de cristaux, la solution mixte obtenue serait inactive sur la lumière, les déviations égales et de sens opposé devant se neutraliser.
Emu, le cœur battant, l’œil anxieux, il observe dans l’appareil de polarisation et s’écrie « Tout est trouvé » ! Pasteur vivait déjà tout ce qui pouvait être induit de cette découverte…, la dissociation de la dissymétrie des cristaux lui ouvrait des horizons dont il pressentait la fécondité.
Laissons-lui la parole :
« L’Univers est un ensemble dyssymétrique. Je suis porté à croire que la vie telle qu’elle se manifeste à nous doit être fonction de la dissymétrie de l’Univers ou des conséquences qu’elle entraîne ».
Il allait même encore plus loin. Une barrière lui apparaissait bien entre les minéraux et les produits de la vie, mais il ne la jugeait pas infranchissable et il avait soin de dire : « C’est une distinction de fait et non un principe absolu ».
Admirable Pasteur qui savait faire partager son enthousiasme à son entourage ! Madame Pasteur écrivait à son beau-père : « Louis se préoccupe toujours un peu trop de ses expériences. Vous savez que celles qu’il entreprend cette année doivent nous donner, si elles réussissent un Newton ou un Galilée ».
Il n’est donc pas étonnant que nous soyons encore nombreux à croire, non seulement à la science, mais à la prescience de Pasteur, prescience qui lui faisait entrevoir des champs d’action que d’autres, tels Jacques Monod, devaient ensuite féconder, et que d’autres, tels Albert Ducrocq mettraient à la portée du public cultivé.

